Les propos recueillis dans cet échange reflètent la reflexion des auteurs interrogés et n’engagent pas les Shifters.
Marion Bet et Mathieu Saujot, modes de vie : la clé de la transition ?
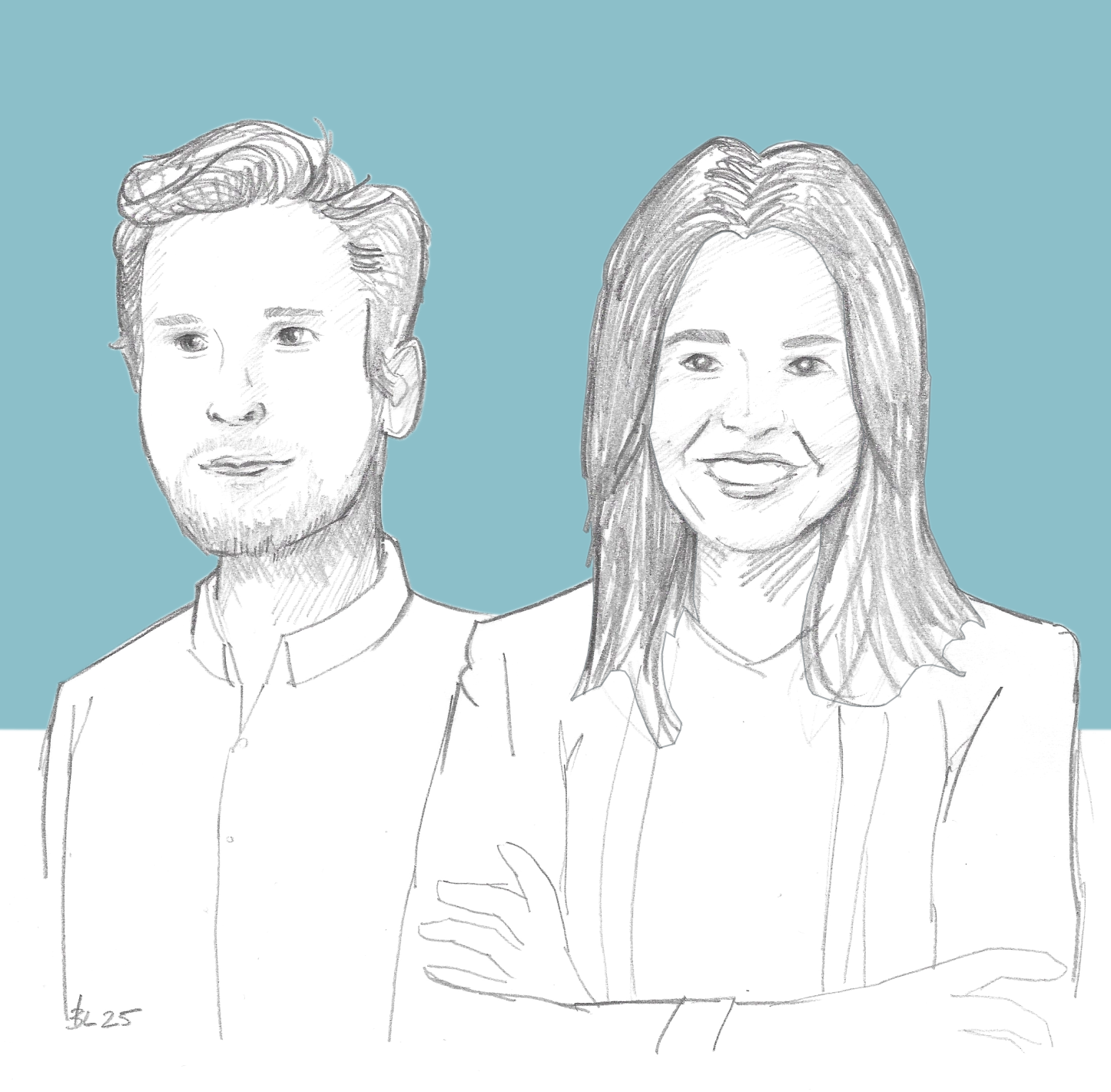
Marion Bet et Mathieu Saujot travaillent tous deux à l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales), un think tank indépendant fondé en 2001, chargé de faciliter la transition durable.
Marion Bet vient de terminer une thèse de philosophie et sciences sociales, et se consacre à présent des sujets tels que la conception d’un nouveau contrat social écologique, des liens entre écologie et justice sociale, notamment à travers l’alimentation. Mathieu Saujot, est quant à lui ingénieur de formation avec une thèse en économie, il travaille à présent comme directeur du programme Mmodes de vie en transition.
Ils viennent de publier avec Clémence Nasr, Charlie Brocard, Sophie Dubuisson-Quellier et Marie Plessz, un texte qui nous a interpellé : «Quand on peut, on veut». Conditions sociales de réalisation de la transition : une approche par les modes de vie.
Tous deux ont été auditionnés par l’équipe de So Shift, le 15 novembre 2024.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez abordé le concept de « mode de vie » et comment il vous permet d’appeler à redistribuer la responsabilité de la transition entre les individus et acteurs privés et publics ?
Cette question de responsabilité nous parait centrale et il faut commencer par rappeler de manière un peu schématique ce qu’a été ce récit de la responsabilité individuelle. L’idée de cette théorie est que le consommateur, via ses actes d’achat, a le pouvoir de réorienter l’offre et la production des entreprises : il est donc un « consomm’acteur ». D’après cette école de pensée, il s’agit donc de renforcer la capacité d’influence des consommateurs en renforçant l’information et la sensibilisation. Cela laisse peu de place aux pouvoir publics et aux acteurs privés, qui n’ont qu’à réagir aux évolutions de la demande des consommateurs.
Nous avons cependant observé les limites de ce discours dans différents domaines, notamment l’alimentation, un champ sur lequel nous travaillons beaucoup. Nous avons identifié deux raisons pour lesquelles l’alimentation durable ne s’est pas naturellement diffusée dans la société, comme le prévoyait la théorie du consomm’acteur.
Les frontières culturelles autour des pratiques
D’une part, il y a des frontières culturelles qui se sont créées autour des pratiques alimentaires, où consommer bio et moins de viande sont devenues des pratiques identitaires. C’est perçu comme un comportement positif pour ceux qui le font, mais cela peut devenir un repoussoir pour d’autres qui ne se retrouvent pas dans ce groupe social. De même, en tant qu’automobiliste, ce n’est pas si facile de passer au vélo car sa pratique est vue comme un marqueur social, même si c’est de moins en moins le cas.
D’autre part, il y a des limites dans la possibilité de traduire nos désirs en actes. On cite toujours les nombreux sondages d’opinion sur la consommation de viande , dans lesquels les Français disent qu’ils veulent réduire leur consommation de viande, qu’ils le font et qu’ils souhaitent continuer à le faire. Or dans le même temps, la courbe de consommation de viande évolue peu. On peut se dire que les gens sont incohérents, ou bien on peut se dire qu’ils ont cette envie mais que lorsqu’ils vont faire leurs courses ou qu’ils réfléchissent à ce qu’ils ont envie de manger, ils sont inondés par des publicités et des offres (plats préparés, services de restauration…) où la viande est très présente. De même sur la question du Bio, pour des habitants qui n’ont pas une seule enseigne d’alimentation bio dans leur quartier, ou qui n’ont tout simplement pas les moyens culturels ou financiers d’avoir accès à cette alimentation, il est aussi très difficile de passer à l’action. Dans le champ de l’alimentation, on parle d’ailleurs d’environnement alimentaire pour désigner ces contextes qui façonnent nos pratiques.
L’importance des environements
Ce que l’on cherche à démontrer avec ces exemples, c’est qu’il est difficile d’avoir un comportement soutenable dans une société où ces « environnements » ne le sont pas eux-même. Notre postulat à travers la remise en question du « quand on veut, on peut », c’est que ce ne sont pas les gens qui résistent, mais que les environnements et les modes de vie présentent des formes de rigidité qui rendent cette transition difficile à réaliser. Cela ne veut pas dire qu’il faut arrêter de sensibiliser les individus aux enjeux environnementaux, en revanche il faut reconnaître que d’un côté, les grands acteurs privés qui structurent l’offre, et de l’autre, les politiques publiques qui investissent dans les infrastructures publiques et ont une activité de régulation, ont un pouvoir supérieur à celui de l’individu avec son caddie. Il nous semble que reconnaître cette responsabilité partagée, permet de rendre les débats sur la transition plus légitimes du point de vue des citoyens et de limiter les effets de rejet ou de désillusion sur ces sujets.
C’est dans cette logique que nous avons travaillé sur le concept de « mode de vie ». Ce qu’on désigne par mode de vie à L’IDDRI, ce sont des habitudes de vie qui vont être communes à des groupes sociaux et qui vont être conditionnées par des structures collectives, des normes sociales, des règles économiques, des offres commerciales qui sont présentes ou non sur un territoire. Des actes aussi fondamentaux que s’alimenter, se loger, se déplacer sont conditionnés par des normes sociales qui évoluent lentement, mais sont aussi restreints par ce qui est mis à notre disposition pour agir dans notre environnement. A ce titre, le concept de mode de vie présente le grand intérêt de faire le lien entre l’individuel et le collectif.
Dans ce cadre de pensée, quel est le rôle des pouvoirs publics dans la transition écologique ?
Si l’on reprend l’exemple de l’alimentation, on réalise bien que les pouvoirs publics sont déjà très actifs sur ce sujet, à travers le soutien à certaines filières, les autorisations de mise sur le marché etc. Contrairement à certaines idées reçues2, la puissance publique, quand elle est capable de le justifier, est donc tout à fait légitime pour agir sur nos modes de vie. Ces interventions publiques doivent apporter des changements d’environnement à quatre niveaux : l’environnement cognitif, par exemple l’information des citoyens, l’environnement physique, par exemple les infrastructures comme les transports en commun, l’environnement socio-culturel avec les normes et les prescriptions, et l’environnement économique avec les prix et les subventions.
Le rôle des pouvoirs publics est donc essentiel pour faire évoluer nos modes de vie. Il y a tout un ensemble de politiques publiques à entreprendre pour faire naître l’envie et rendre possible la responsabilité de la transition. Mais tant que ces environnements, ces infrastructures, cet ensemble de régulations et de normes ne sont pas présents, et pas mis en œuvre par l’État, c’est incertain. Ça ne veut pas dire d’ailleurs que l’État doit le faire sans concertation avec les citoyens. Nous pensons que cela doit être mis en œuvre de la façon la plus démocratique possible en consultant, délibérant, négociant avec les citoyens. Mais c’est quand même quelque chose qui doit être entrepris du côté des politiques publiques. Le changement à engendrer est plutôt structurel.
On se demandait si vous aviez déjà fait des expérimentations sur le terrain, ou si votre discours restait encore dans le domaine de la théorie.
Entre la théorie et l’expérimentation… C’est une très bonne question. Le travail que nous réalisons dans le domaine de l’alimentation s’appuie sur une vaste littérature empirique notamment de sociologie, qui étudie les comportements, les pratiques, les modes de vie au plus près, que ce soit par des données quantitatives, des entretiens, des campagnes. La recherche est extrêmement abondante sur le sujet. Nous publierons d’ailleurs un scénario inédit de transition alimentaire - TRAMe2035 - début février. Pour la suite de notre travail, nous aimerions pouvoir développer cette partie empirique, y compris sous forme d’observatoire. pour identifier dans quels cas ou territoires il semble possible de changer les modes de vie collectifs, en activant quatre leviers : les normes socio-culturelles, les moyens financiers (des ménages notamment), les infrastructures disponibles et, enfin, tout ce qui à trait aux compétences (savoir cuisiner, transformer une alimentation végétale, etc.) et facultés cognitives. Ce n’est qu’en jouant sur ces quatre dimensions que les gens peuvent « changer ». Par ailleurs, la magnitude de la transition et les crises qui nous font face imposent de réfléchir aux conditions sociales de manière encore plus large que la seule question des modes de vie, et nous mobilisons le concept de contrat social pour cela. Marion a ainsimené 20 entretiens d’1h30 avec des Françaises et des Français issus de territoires diversifiés, de cultures et bords politiques divers aussi, pour les faire parler sur leur parcours de vie en abordant les quatre thèmes sécurité, démocratie, consommation et travail.
Un contrat social implicite
Ce dont on se rend compte, c’est qu’en faisant parler les gens sur leur parcours de vie, ils parlent implicitement de contrat social. Ils parlent des attentes collectives, des promesses déçues et tenues, et expriment des avis sur la façon dont cela pourrait fonctionner. Ce qui est frappant, c’est que les personnes établissent, de manière spontanée et sans qu’on les y pousse, des causalités qui sont sociales, collectives, dans ce qui leur arrive. C’est-à-dire qu’elles vont avoir tendance à expliquer une réussite ou un échec dans leur vie personnelle par un phénomène social plus large.
Par ailleurs, nous avons noté le sentiment très largement partagé que notre contrat social est rompu ou qu’il ne remplit plus un certain nombre de promesses. Il y a vraiment un sentiment de dégradation, voire de déclassement, à l’œuvre chez les personnes interrogées.
Ce qui validait en quelque sorte notre cadre théorique, c’est que nous avons fait très attention à ne jamais mentionner le terme de contrat ou de pacte, dans nos questions d’entretien. Or le fait est que les personnes avaient spontanément recours, dans leurs réponses, à l’image du contrat ou du système gain-compensation pour figurer la vie économique et sociale. Nous avons donc établi la confirmation que cet imaginaire contractualiste pour représenter notre vie sociale existe bel et bien.
Justement, dans un autre de vos rapports, qui s’appelle « Vers un contrat social pour le XXIe siècle, comment en sommes-nous arrivés là ? »5, vous évoquez la fragilité actuelle de ce contrat social. Quel serait le contrat social qui rendrait ces changements que vous proposez attractifs et pérennes pour tous les groupes sociaux, y compris les plus vulnérables ?
Voici la raison pour laquelle nous avons été amenés à travailler sur cette question de contrat social : il y a quelques années, nous organisions un webinaire avec différents experts et chercheuses autour de la question de la sobriété, de la façon dont on peut, dans les scénarios et les prospectives, représenter justement ces changements sociaux. A la fin de ce webinaire, Sophie Dubuisson-Quellier, qui est chercheuse associée et sociologue, nous a dit qu’il restait à inventer le contrat social de cette société sobre, car notre contrat social actuel est construit autour de l’abondance. Nous l’avons prise au mot et nous avons développé ce projet.
Un deuxième éclairage vient de Bruno Latour, avec la métaphore du scrabble. Ce qu’elle nous dit, c’est qu’un promoteur de la transition qui imagine des solutions techniques et économiques, c’est un peu comme avoir un très beau mot sur un chevalet de scrabble. Vous êtes focalisé sur votre mot mais vous ne comprenez pas très bien comment le placer sur le plateau de jeu dont certaines cases sont déjà remplies. Le plateau de jeu représente la société et les cases remplies, ses contraintes.
Ce que l’on cherche à proposer avec cette notion de contrat social, c’est d’utiliser l’ensemble du « plateau de Scrabble », de voir les arrangements, les droits, les devoirs, les contraintes, pour mieux appréhender la manière dont on va réussir à mettre en œuvre la transition.
Ces deux points de départ nous ont aidé à réfléchir à ce que seraient les fondements de ce contrat social.
Progressivité et différenciation
Le premier fondement de ce contrat social est celui de la progressivité et de la différenciation en fonction des groupes sociaux, dans la manière de les faire contribuer à la transition. Cette progressivité dans la contribution se justifie par le fait que tous les groupes sociaux n’ont pas le même degré de contribution à la pollution, ni la même responsabilité dans la consommation générale. A ce titre il serait injuste de faire contribuer tous les groupes de la même manière.
Nous en avions parlé dans un papier avec mon collègue Andreas Rudinger au moment de la crise énergétique qui s’appelait «Faire rimer sobriété et solidarité»3. Nous disions par exemple qu’il peut y avoir une tarification progressive de l’eau, ce qui est d’ailleurs déjà expérimenté par certaines collectivités. On peut aussi avoir des règles sur l’usage de l’avion, sur le poids des véhicules, comme la convention citoyenne l’avait proposé. Il y un certain nombre de règles, qui existent parfois déjà, qui font en sorte que ceux d’en haut jouent leur rôle, voire le jouent peut-être un peu plus. Nous soulignions que l’exemplarité des élites est vraiment importante.
Cette idée reprend des éléments mis en évidence par Philippe Coulangeon [4]. On se rend compte que les plus aisés peuvent être les plus expressifs d’une préoccupation écologique, tout en étant les plus consommateurs. A l’inverse, un certain nombre de classes modestes peuvent se révéler rétives aux discours écologiques, voire développer une réaction de rejet alors qu’ils sont les plus sobres. En réalité, la préoccupation écologique est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit et il y a beaucoup d’initiatives, par exemple, dans les quartiers populaires.
Des promesses qui structurent notre vie sociale
Le second principe que nous proposons est celui d’un contrat social attentif aux arrangements collectifs qui structurent aujourd’hui encore notre vie sociale. Il y a plein de promesses aujourd’hui en lesquelles croient un bon nombre de groupes sociaux, et qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main : la promesse du droit au travail, la promesse de l’identité et du statut par le travail, la promesse de mobilité sociale, la promesse d’abondance etc. Toutes ces promesses sont très incarnées, et leur mise à mal crée du rejet quant à la transition. Il faut donc être très attentif à ces promesses. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas les renouveler, mais le chemin pour les renouveler doit être pris en compte, c’est une véritable étape en tant que telle.
Une nécessaire participation des citoyens
Le troisième principe est celui de la participation des citoyens, afin que le contrat social ne soit pas seulement pensé par le haut, par l’État. Impliquer les citoyens dans l’élaboration d’un nouveau contrat social est la seule manière de rendre une transition non seulement acceptable, mais aussi juste et pertinente, parce qu’accordée aux besoins sociaux et aux aspirations des différentes classes sociales mises à contribution pour la négociation de ce nouveau contrat. Quelle que soit la forme prise par la participation des citoyens, cela nous parait être une nécessité à la fois politique et méthodologique. Ce ne serait pas la première fois que les sociétés humaines se constitueraient leurs propres lois, en se détachant des lois divines ou royales. L’histoire nous rappelle que, oui, notre contrat social évolue et que le citoyen a un rôle central à jouer dans cette évolution. Plus récemment, la convention citoyenne a montré la capacité des citoyens à débattre de ces sujets complexes et la grande qualité qui pouvait exister dans ces délibérations, avec toutes les limites qu’il y a pu avoir dans cet exercice.
Être lucide sur les mécanismes d’inégalité
Enfin, le contrat social qui doit advenir doit être lucide sur les mécanismes d’inégalité qui ont pu caractériser notre contrat social actuel. Un certain nombre de philosophes et de sociologues (cités dans notre article) ont mis en évidence que derrière notre contrat social actuel, il y a ce qu’on peut appeler un contrat racial ou un contrat sexuel, un contrat économique, qui provoquent un certain nombre de dominations, d’inégalités. Notre contrat social est le résultat d’une vision qui l’a emporté sur d’autres, mais ce n’est pas du tout la seule vision qui a pu exister. Il y a souvent un rapport de force dans l’élaboration d’un contrat social : cela peut être la vision d’une classe dominante qui l’emporte, cela peut être la victoire d’un mouvement social, mais pas toujours. Comment peut-on réintroduire de la justice et de l’équité dans nos arrangements collectifs ? C’est à cela que doit s’intéresser le nouveau contrat social, et c’est à ce titre qu’il pourra être accepté par les plus modestes et les classes moyennes.
À quel niveau ce nouveau contrat social doit-il advenir ?
Il y a des échelons politiques qui sont plus près du terrain, les collectivités régionales, départementales, les métropoles, et on a parfois le sentiment que ce sont ces niveaux de collectivité qui donnent le plus le moyen aux citoyens de s’investir. Or là, sur la question du contrat social, c’est vrai qu’on pense tout de suite à des échelons supérieurs, mais finalement, est ce que ce contrat social ne peut pas se construire à partir des collectivités régionales, qui expérimentent ?
Le rôle des échelons politiques qui sont plus près du terrain, comme les collectivités régionales, départementales, les métropoles est important, notamment pour l’expérimentation de certaines nouvelles politiques publiques telles que la sécurité sociale alimentaire. Les collectivités locales jouent également un rôle clé dans la mise en discussion des enjeux. À Lyon, par exemple, la convention citoyenne sur le plan climat permet d’aborder des questions très concrètes telles que l’organisation du travail en période de canicule, la régulation de la climatisation, la végétalisation des espaces urbains avec des arbitrages par rapport à d’autres usages etc.
Pour autant cet échelon, qui est très pertinent en tant que laboratoire, nous parait avoir des limites vis à vis de l’échelon national notamment face à des acteurs privés qui sont des multinationales. Il y a sans doute là un biais personnel autour de la notion d’état social, qui ne reflète pas le positionnement de l’IDDRI en tant que think tank, mais nous pensons tous les deux qu’un état assez fort est tout de même nécessaire pour organiser les solidarités au niveau national, garantir des protections face au marché, financer des dispositifs dans les territoires. Cela reste notre opinion et il est certain que l’organisation de sociétés plus robustes et respectueuse des enjeux sociaux et environnementaux sera sans doute celles que choisissent les groupes sociaux eux-mêmes.
Il faut également s’interroger sur le cadre de ce contrat social : faut-il réfléchir à un contrat social français ou européen ? L’IDDRI collabore avec des acteurs allemands et italiens car nous voyons bien que l’échelon européen est absolument central et qu’une vaste partie de notre héritage sociopolitique est partagé avec nos amis européens. Pour autant, ces discussions sont complexes à avoir, d’autant plus à large échelle, et il est difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas un premier processus de réflexion au niveau national.
Quel est le rôle du chercheur dans l’écriture de ce nouveau contrat social ?
Est-ce à nous de faire des préconisations? Nous nous considérons comme d’humbles acteurs qui essaient de formuler des questions pour aider à structurer le débat citoyen, à côté d’autres acteurs qui réfléchissent à ces enjeux politiques et sociaux. Nous sommes persuadés que, bien que de nombreuses questions apparaissent comme techniques, elles doivent être débattues par le grand public parce qu’il en découle des choix politiques qui nous concernent tous.
Notre rôle est de donner un cadre pour débattre et poser ces questions : « Est-ce qu’on peut voir le problème selon la question des modes de vie et des environnements ? Quelles seraient les conditions si on voulait le mettre en œuvre ? »
Il n’y a pas de recette miracle, mais nous avons quand même appris des choses sur l‘ensemble des leviers qui permettraient d’assurer que chacun joue un rôle dans la transition, et de recréer du consensus autour de la transition
Pour aller plus loin
1 Article 24/09/2025, Mathieu Saujot, Clémence Nasr, Charlie Brocard, Marion Bet, Sophie Dubuisson-Quellier, Marie Plessz, «Quand on peut, on veut». Conditions sociales de réalisation de la transition : une approche par les modes de vie, IDDRI
Voir la page
2 Article 16/06/2022, Thomas Wagner, 10 idées reçues sur la sobriété des modes de vie, BonPote
Voir la page
3 Article 22/10/2025, Mathieu Saujot, Andreas Rudinger, Un besoin urgent de faire rimer sobriété et solidarité, IDDRI
Voir la page
4 Ouvrage 04/012023, Maël Ginsburger, Philippe Coulangeon, Yoann Demoli, Yvaylo Petev, La conversion écologique des Français : Contradictions et clivages, PUF, Collection Lien social(le)
Voir la page
5 Publication juin 2024, Mathieu Saujot, Marion Bet, Saamah Abdallah, Magnus Bengtsson, Charlotte Rogers, Vers un contrat social pour le XXIe siècle, comment en sommes-nous arrivés là ?, IDDRI
Voir la page
